 |
| L'Angoumois dans tous ses états ... |
|
|
|
| |
|
| |
|
 |
| Personnes célébres |
 |
|
|
 |
 |
Honoré de Balzac (Tours 1799 - Paris 1850)
Honoré de Balzac, avant d'être homme de lettres, fut éditeur, puis imprimeur et fondeur de caractères typographiques, entre 1824 et 1828. L'aventure tourna court mais nourrit par la suite son œuvre et en particulier son ouvrage "monstre", Illusions perdues, dans lequel il raconte l'histoire de David Séchard, petit imprimeur de province et de son ami Lucien Chandon qui fréquenta le petit monde de l'édition parisienne. En 1839, il est élu président de la Société des Gens de Lettres. Il voyage beaucoup, notamment en Italie et en Ukraine. Il séjourna au château de Verteuil où il fit naître Eugène de Rastignac personnage de la Comédie Humaine qui apparaît pour la première fois dans le Père Goriot. Dès 1829 et ce jusqu'en 1847, Balzac se lance dans la plus grande aventure de sa vie, la rédaction de la Comédie Humaine, une grande fresque de la société française de la Révolution à la fin de la monarchie de Juillet (de 1830 à 1848). Plus de 2000 personnages font vivre cette épopée, hantée par le spectre du pouvoir de l'argent et de la presse. Plus de 90 ouvrages la composent. Parmi ces romans, vous retrouvez La Peau de Chagrin (1831), Le Colonel Chabert (1832), Le Médecin de Campagne et Eugénie Grandet (1833), Le Père Goriot (1834-35), La Cousine Bette (1846) ou encore le Cousin Ponce (1847). Il épouse une ukrainienne, Madame Hanska, à la fin de sa vie.
|
 |
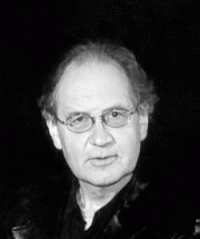 |
Michel Boujut (Jarnac-sur-Charente 1940 -)
Michel Boujut est critique de cinéma et écrivain. Il grandit à Jarnac et s'intéresse très tôt au cinéma. François Truffaut lui apporte ses premières émotions cinématographiques. Son père, Pierre Boujut, tonnelier, marchand de fer et de futailles et poète, créé et publie à Jarnac pendant quarante ans la revue de poésie, La Tour de Feu, qui entraîne dans son sillage nombre de vocations littéraires. Michel apprend son métier de journaliste, à la télévision suisse, à Genève (TSR). Il y fait de nombreux reportages en Suise et à l'étranger. Sa participation en tant que producteur de l'émission mensuelle "Cinéma Cinéma" sur Antenne 2 lui sert d'intronisation dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, il est chroniqueur sur France Inter, producteur à France Culture. Il est l'auteur de livres, comme La Promenade du critique ou Le Jeune Homme en colère, ainsi que de portraits de Wim Wenders et Claude Sautet. Boujut a également travaillé sur un album de bande dessinée, Un Strapontin pour deux (1995), en collaboration avec Tardi.
|
 |
 |
Claude Boucher (1842-1913)
En pleine Révolution Industrielle, Claude Boucher inventa en 1898 un procédé révolutionnaire pour tous les producteurs de cognac et de pineau des Charentes : celui du soufflage automatique du verre. Boucher cherchait en effet à améliorer les conditions de travail des ouvriers verriers et à limiter les conséquences néfastes du soufflage du verre sur leur santé. Cette invention profita également aux producteurs de vins. Elle permit d'augmenter la production de bouteilles de verre et d'améliorer la conservation de l'alcool. Le brevet de Claude Boucher fit le tour du monde.
|
 |
 |
Burgaud des Marets (1806-1873)
Un portrait par Deveria (1856) souligne la finesse du regard de ce fils de Jarnac (Charente), qui compta parmi les plus brillants esprits de son temps. Il écrivit notamment Fables et contes en patois saintongeais (1859), précieux témoignage linguistique et savoureux monument littéraire.
|
 |
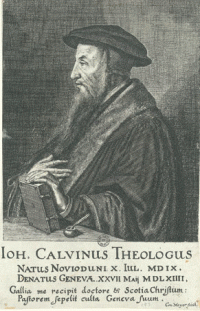 |
Jean Calvin (1509-1564)
Il naît à Noyon (Picardie) le 10 juillet 1509 d'un père notaire et conseiller juridique du diocèse de Noyon et d'une mère très pieuse. Son père percevant des revenus confortables, le jeune Calvin peut poursuivre sans problème ses études. Après des études au collège des Cappettes à Noyon, il se rend à Paris au collège de la Marche puis à celui de Montaigu (où il rencontre Ignace de Loyola). Calvin étudie sans relâche, jusqu'à mettre même sa santé en danger. Les textes de l'Antiquité latine et de l'Eglise n'ont plus de secret pour lui. Mais son père décide qu'il doit changer de voie et lance son fils dans une carrière de juriste. Jean va étudier à Orléans puis à Bourges avant de revenir à Paris. Ses études de droit terminées, il se tourne vers les lettres. Son Commentaire du "De clementia" de Sénèque, rédigé en 1532 à l'âge de 23 ans, le fait rapidement connaître dans les milieux littéraires.
Il séjourne en Angoumois chez son ami Louis du Tillet, chanoine d'Angoulême et curé de Claix, près de Mouthiers-sur-Boëme. Passant d'un lieu à l'autre, il y prêche clandestinement d'où les noms attribués par la tradition à « la grotte à Calvin » qui répondit à « la chaire à Calvin », près de Poitiers- ville où il trouve refuge en 1534 après l'affaire des Placards qui alarma François I°.
En 1534 éclate l'affaires des Placards où de nombreux textes anti-protestants sont affichés sur les murs de Paris. Calvin se range du côté de la Réforme (mouvement qui donne naissance aux Eglises Protestantes). Il s'enfuit à l'étranger et se retrouve à Bâle en 1536 où il l'Institution de la Religion Chrétienne. Il est alors considéré comme un brillant théologien de la Réforme. Son ouvrage est en effet adressé à François 1er pour défendre les protestants persécutés. Jean Calvin est appelé à Genève. Il n'y reste alors que peu de temps, ayant des divergences d'opinions avec un magistrat. Il se retire à Strasbourg où il exercera la charge de pasteur de la paroisse française de 1538 à 1541. Mais rappelé à Genève, il y reste jusqu'à sa mort. Il y écrit de nombreux ouvrages de théologie, d'exégèse, de commentaires bibliques, de correspondances, etc. Malade, il meurt le 27 mai 1564. Son crédo restera toujours : "Dieu est au-dessus de tout".
|
 |
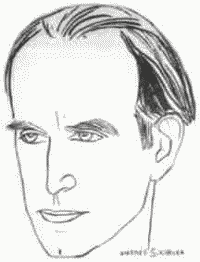 |
Jacques Boutelleau, dit Chardonne (1884-1968)
Écrivain né à Barbezieux, mort à La Frette sur seine. Fils de Georges Boutelleau, administrateur de la Société vinicole, romancier et poète, il évoqua son enfance et sa jeunesse dans sa ville natale dans un texte autobiographique publié en 1938 sous le titre le Bonheur de Barbezieux.
Auteur de quelques 20,000 lettres, celles sur papier quadrillé son sincères, dans celles sur papier blanc il mentait. Ses amis connaissaient cette convention.
"L'épithalame" (1921) son premier livre le révèle en romancier du couple. "Les Varais (1929); "Eva" (1930); "Claire" (1931).
Il décrit avec mélancolie et finesse, en romancier et moraliste. "L'amour du prochain" (1932); Jarnac.
Dans l'entre-deux-guerre, autour de lui un groupe d'écrivain est tres actif: Henri Fauconnier, Geneviève Fauconnier, Maurice Delamain, Jacques Delamain, Germaine Boutelleau.
[1937] "L'amour, c'est beaucoups plus que l'amour";
"En Charente, le printemps commence aux branches du saule et du bouleau par des flocons d'ouate ou des pendeloques de velours. Sur les coteaux, on taille la vigne, on laboure. Le sol retourné montre sa bigarrure: terre argileuse mêlées de sable où la charrue semble laisser dans les sillons fraîchement ouverts un reflet d'acier, terre calcaire qui paraissent toujours un peu desséchées, terres rougeâtre, terre cendreuses qui pâlissent au soleil avec un ton bleuté, ou bien qui gardent dans l'humidité comme un fond de suie." (71ko)
[1938] "Le bonheur de Barbezieux";
"Mais d'abord, je veux revoir mon pays... Tout d'un coup, la vue est immense et découvre des crêtes crayeuses doucement infléchies, comme modelées, atténuées par un long travail, et, plus loin encore, des ondulations bleues que l'horizon dilue. Les noyers, bouquets de feuillages piqués dans les vignes, les champs et leurs teintes de vieille tapisserie, les peupliers dans les bas-fonds ont je ne sais quoi de grave sous la lumière onctueuse d'octobre. Parmi tant d'aménité on sent poindre le sol de craie et comme la nudité du proche hiver. Rien ne frappe d'abord, même la lumière, dans ce pays sans pittoresque, à la fois verdoyant et un peu désertique, souriant et infiniment triste, où l'homme invisible est si mêlé à la terre. Mais ce n'est pas le sentiment d'une beauté secrète, inventée peu après, qui me plaît c'est la certitude d'une beauté réelle garantie par son dénuement exquis. Elle n'est saisie que par une longue connaissance et une sorte d'amitié."
"Je suis né dans une petite ville où j'ai vécu longtemps, mais j'ignorais que ce fut une petite ville, une de ces bourgades endormies, qui fait pitié au Parisien quant il les traverse en voiture. Elle me paraissait vaste, bien pourvue et très animée."
|
 |
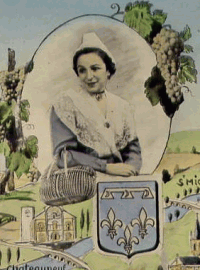 |
Odette Comandon (1913 - 1996)
Née en 1913, à Angoulême, elle emménage dans sa maison de Jarnac en 1934, après avoir épousé Étienne Comandon. Auteur de comédies patoisantes et de contes (les Nouveaux Contes de Cagouille), elle crée le personnage populaire de la Jhavasse, commère à la langue bien pendue (du verbe saintongeais 'jhavasser', jacasser).
|
 |
 |
Maurice Coupeaud (? - ?)
C’est au génial Maurice Coupeaud, inventeur charentais, que l’on doit cette invention en 1937. La première ville a utiliser le cyclopousse fut Phnom Penh. En 1939, Coupeaud voyagea de Phnom Penh à Saigon en cyclopousse en 17 heures and 23 minutes. C’est ainsi que le premier cyclopousse entra au Vietnam. A la fin de 1939, il y avait 40 cyclo dans Saigon. Ce nombre a progressé rapidement jusqu’à 200 une année après. Combien de générations de coolies, tirant auparavant le passager à la force des bras, lui doivent cette amélioration de leurs conditions de travail depuis 1938 ! Est-il un monument, une rue ou un musée qui porte son nom dans notre (la sienne et la mienne) Charente natale … L’origine apocryphe de l’inversion entre le passager et le chauffer est une décision d’un gouverneur général, il souhaitait ainsi éviter qu’au homme vietnamien se place entre les jambes d’une femme française. Cette version est soumise à controverse puisque dans diverses régions du vietnam les conducteurs sont devants.
Pour ceux qui lisent le Vietnamien, un article du journal Cong Luan, du 19 janvier 1937 Décrit l’introduction du cyclopousse dans Saigon.
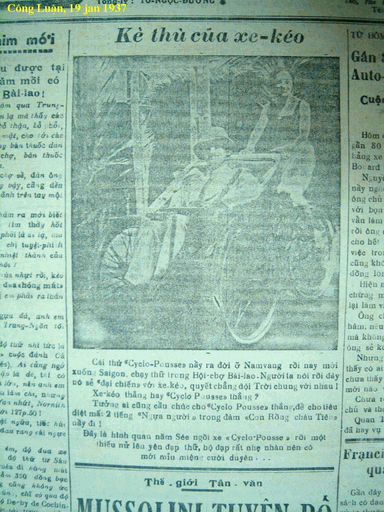
Sources :
Vietnam Studies Group
Cortour Vietnam
|
 |
 |
Jean-Pierre Coutanceau dit Peûlouc (1967 - / )
Cet auteur à obtenue le prix récompensant un auteur en langue Saintongeaise ou patois Charentais. Auteur, conteur patoisant, il doit son surnom "Peûlouc" à une épaisse chevelure traduction de "poils de loup".
Il a écrit un livre "Les beunasses,les fumelles et les cheuns", un recueil de contes, des poésies ("Moun ile d'épagna" qui sera publié cet automne qui sera suivie d'un CD comportant deux sketches "la star académique" et "peurmier bécot"), des réflexions et dessins.
|
 |
 |
Robert Couturier (Angoulême, 1905 - / )
Ses parents s'installent à Paris en 1910 où il fait ses classes élémentaires. En 1918, il entre à à l'école Estienne pour apprendre la lithographie. Entre 1922 et 1924, la mort de son père l'oblige à interrompre ses études pour gagner sa vie. Il travaille chez Mourlot et Mourgue où il met en pratique ses études de lithographie en exécutant des reproductions, des affiches publicitaires ou des dessins de publicité. Couturier est amené par la suite à diversifier ses activités. Il exécute des décors au Théâtre de la Chauve Souris d'après des maquettes de Derain, Marie Laurencin, Alexandre Benois. Il est dessinateur de publicité au Petit Parisien, à l'Excelsior, puis comptable aux Messageries Hachette. Il pose comme modèle pour le sculpteur Armand Bloch auprès duquel il commence à faire ses premières sculptures. C'est à partir de cetté époque que se dessine sa carrière de sculpteur. Sa rencontre avec Maillol en 1928 est alors déterminante. Ce dernier l'invite à venir travailler avec lui dans son atelier. Il commence par travailler la pierre, en y scultant des oeuvres aux formes amples. Puis il s'oriente vers le plâtre coulé sur des bâtis rapides de bois et de fils de fer, réalisant tout d'abord des formes humaines très effilées. On lui remet le prix Blumenthal en 1930. Il participe à diverses expositions entre 1934 et 1969 : Galeries, salons, expositions internationales, également aux Biennales de Venise et de Sao Paulo et aux expositions en plein air à Anvers et à Arnhem. Sa notoriété grandit. Il reçoit la médaille de l'Ordre des Arts et Lettres 1962, de la Légion d'Honneur 1965 et de l'Ordre du Mérite 1967.
|
 |
 |
François-Marie Sadi Carnot (Limoges 11 août 1837 - Lyon 24 juin 1894)
Petit fils de Lazare Carnot, François-Marie est reçu cinquième à l'École Polytechnique en 1857. Il entre ensuite à l'école des Ponts et Chaussées dont il sortira major en 1863. Il débute sa carrière professionnelle comme secrétaire adjoint au Conseil supérieur des Ponts-et-Chaussées, puis ingénieur en chef de la Haute-Savoie. Mais sa carrière politique s'envole lorsqu'il est nommé préfet de la Seine-Inférieure en 1871 après la chute du Second Empire. Il est par la suite élu député de la Côte d'Or. Dès 1880, il entre dans le gouvernement français en temps que sous-secrétaire d'État aux Travaux Publics. Puis de Ministre des Travaux Publics, il passe Ministre des Finances en 1885. Le scandale des décorations pousse le président de la République à démissionner. Sadi Carnot est ainsi désigné Président de la République en remplacement de Jules Grévy le 3 décembre 1887. Le début de son mandat est marqué par l'agitation boulangiste (il signa le décret mettant à la retraite d'office le Général Boulanger), par le ralliement de nombreux catholiques au régime républicain (1890) et les scandales de Panama (1892). Mais la carrière de Carnot devait être brutalement interrompue. Il est en effet assassiné par l'anarchiste Caserio le 24 juin 1894 lors de l'Exposition de Lyon. Sadi Carnot est enterré au Panthéon à côté de Lazare Carnot, son grand-père.
|
 |
 |
Maria Casarès (La Corogne, 1922 - La Vergne, Charente-Maritime, 1996)
Née en Galice, à La Corogne, le 21 novembre 1922, fille d'un ministre républicain, Maria Casares Quiroga doit s'exiler en France après la victoire du franquisme. Elle entre au Conservatoire national d'art dramatique à Paris dans le cour de Béatrix Dussane. En 1942, elle fait ses débuts sur les planches dans 'Deirdre des douleurs' de Marcel Herrand. Vers la fin des années quarante, elle travaille sur des pièces d'Albert Camus, comme 'le Malentendu', 'l'Etat de siège' (1948) et 'les Justes' (1949). Au début des années cinquantes, la Comédie-Française l'accueille en son sein. Mais elle n'y reste pas longtemps et choisit d'intégrer le Théâtre national populaire (TNP) de Jean Vilar. Sa carrière décole grâce à ses prestations remarquées lors du Festival d'Avignon. Elle y interprète Shakespeare, Marivaux, Strindberg, Claudel et Genet. Elle tient tous les grands rôles dramatiques et ses admirateurs en redemandent. Ils sont en effet tous séduits par sa voie rocailleuse et ses grands yeux verts.
Les grands et petits écrans l'appellent également à eux pour des films inoubliables, comme 'les Enfants du paradis' (1945) de Maurice Carmé, mais aussi 'les Dames du bois de Boulogne' (1945) de Robert Bresson, 'la Chartreuse de Parme' (1948) de Christian-Jaque avec Gérard Philipe, 'Le Testament d'Orphée' de Jean Cocteau (1960) (sublime dans le rôle de la Mort vaincue par l'amour). Plus récemment, elle avait tourné pour Godard 'Histoires de cinéma' et pour Deville 'la Lectrice' (1988).
A soixante ans passés, elle continue d'enchanter le public avec le 'Roi Lear' en 1993, au Centre dramatique national de Gennevilliers, dans la bataille des 'Paravents' de Genet, en 1966, à l'Odéon avec les Renaud-Barrault, à 'la Nuit de Madame Lucienne', de Copi, en 1985, à 'Quai Ouest', de Koltès, en 1986, à 'Elle est là', de Nathalie Sarraute, en 1986, à 'Comédies barbares', de Valle Inclan en 1991. A l'automne 1990, l'actrice joue même simultanément deux rôles dans deux pièces au théâtre de Gennevillers: Madame Pernelle dans le 'Tartuffe' de Molière par Sobel et 'Elle' mis en scène par Bruno Bayen. Les récompenses les plus illustres ont été données à cette actrice espagnole, comme la Légion d'honneur ou la médaille des Arts et des Lettres. Maria Casarès meurt en 1996, à soixante-quatorze ans, dans sa campagne de Charente.
|
 |
 |
André Chabanne (1914 - 1963)
Le colonel André Chabanne, enfant du pays, ancien instituteur à Chasseneuil, s'engagea dans la résistance française lors de la seconde guerre mondiale. A la fin de la guerre, Chabanne eu l'idée d'ériger un monument à la gloire des résistants morts pour leur pays. Ce mémorial, une croix de Lorraine de 21 m de hauteur visible de très loin, fut inauguré à Chasseneuil en 1951.
|
 |
 |
Eugène Delacroix (Charenton-St-Maurice 1798 - Paris 1863)
Fils de Charles Delacroix, haut fonctionnaire de la Révolution et de l'Empire, et de Victoire Oeben, fille du fameux ébéniste de Louis XVI, Eugène Delacroix pert très tôt ses deux parents. En 1817, alors qu'il n'a que 19 ans, il entre dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin, où il rencontre Géricault, les frères Scheffer ou le paysagiste Paul Huet. Il devient d'ailleurs bientôt le chef de l'école romantique en peinture. Ses tableaux s'exposent aux Salons de 1822 et 1824. le public et les critiques découvrent alors les oeuvres Dante et Virgile et les Les Massacres de Scio. C'est l'adversaire d'Ingres et des classiques. Eugène Delacroix se lie d'amitié des artistes de l'époque, écrivains, peintres et musiciens : Stendhal, Hugo, Chopin, George Sand, Dumas, Mérimée, Barye ou Delaroche. Le tableau La Liberté guidant le peuple (1830) est un des plus célèbres de Delacroix. C'est le témoin de son engagement politique pour la Révolution des Trois Glorieuses et l'avènement de Louis-Philippe. Lors d'un voyage au Maroc, Delacroix se découvre une passion pour les chevaux. A partir de 1822, les chevaux jouent un rôle particulier dans la peinture de Delacroix. Ses peintures sont enflammées, toujours en mouvement, révélant une force sous-jacente.
Ayant des entrées dans les milieux politiques, notamment auprès de Louis-Philippe, il peint de vastes peintures murales au musée du Louvre (Apollon vainqueur du serpent Python, un plafond dans la galerie d'Apollon), à l'Hôtel de Ville de Paris, au Sénat ou au Palais Bourbon. Il peint également de grandes compositions historiques, telles la Prise de Constantinople par les croisés et la Bataille de Poitiers (Paris, musée du Louvre) ou la Bataille de Nancy (Nancy, musée des beaux-arts), trouvant également ses sources d'inspiration souvent dans la littérature. Balzac apprécie énormément le travail du peintre et lui dédie plusieurs de ses romans.
|
 |
 |
Louis Delage (1874-1954)
Né dans une famille modeste de Cognac, il vécut à une centaine de mètres de l'actuel lycée Louis Delage. En 1890, il entre à l'école des Arts et Métiers d'Angers et en sort en 1893 avec le titre d'ingénieur. De 1894 à 1895, il est envoyé en Algérie dans le cadre de son service militaire. De retour en France, Louis Delage entre à la compagnie des Chemins de Fer du Midi où il est surveillant de travaux à Bordeaux. Mais Louis va rapidement développer un intérêt certain pour le secteur automobile. Bon dessinateur, il entre au bureau d'études des Automobiles en 1900. Rapidement la société Peugeot le remarque et l'engage comme chef des études et des essais à Levallois, en 1903. C'est en 1905 que la grande aventure Delage commence. Sa nouvelle usine de Courbevoie se spécialise dans les voitures de luxe et l'automobile de course. Louis Delage fait participer ses voitures avec succès à différentes courses de voitures, comme à Indianapolis en 1914. En 1923, les Delages battent un record de vitesse avec 230 Km/h. Mais le constructeur produit également de belles voitures de tourisme. Le 27 août 1930, Louis Delage se marie à Paris avec Solange, Henriette ACHARD. Mais en avril 1935, la société tombe entre les mains d'un liquidateur. Elle est reprise par Delahaye. Louis Delage se réfugia alors dans la religion et entreprit des pélerinages à pied et à bicyclette. Aprés la guerre, un de ses anciens employés, Paul Yvelin, le verra, vêtu comme un clochard. Le 14 décembre 1947, Louis DELAGE décède à Pecq, dans les Yvelines. Le nom prestigieux DELAGE survivra sur les calandres de voitures jusqu'en 1954, année où les noms Delahaye et Delage furent absorbés par Hotchkiss. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Amis de Louis Delage : http://www.delage.org.
|
 |
 |
Gustave Flaubert (1821-1880)
Il naît à Rouen (Seine-Maritime) le 12 décembre 1821 dans l'hôpital où exerce son père en qualité de chirurgien en chef. Gustave est un enfant délaissé par ses parents qui le préfèrent à son frère aîné, brillant élève. En 1825, la famille embauche une nouvelle gouvernante, Julie. Cette dernière comptera énormément pour Flaubert qui la dépeindra sous les traits de Félicité dans Un Cœur Simple. En février 1832, Gustave entre au Collège Royal de Rouen. C'est un bon élève. Avec sa famille, il part chaque été à Trouville. C'est là qu'il y rencontre Elisa Schlésinger, épouse de Maurice Schlésinger, directeur de la Gazette et revue musicale de Paris. Entre eux, toute histoire est impossible. Gustave en souffre et parlera de cette passion dans les Mémoires d'un fou et les deux versions de l'Education sentimentale.
Pendant ses études, Gustave écrit de plus en plus. Sa vocation se précise. Il fait ses premières armes dans le Colibri, une revue littéraire de Rouen. Y sont publiés Bibliomanie et Une leçon d'histoire naturelle. En 1839, Gustave entre en classe de philosophie, mais en est rapidement exclu. Il passe seul son baccalauréat avec succès en 1840. Entre 1841 et 1843, Flaubert est envoyé à Paris poursuivre des études de droit qui le rebutent. Fin 1843, il écrit la première version de l'Education sentimentale. En janvier 1844, une crise nerveuse d'une extrême violence le force à arrêter ses études. Cette crise n'est hélas que la première d'une longue série. Gustave est soigné à Croisset, auprès de sa famille. Lors de sa convalescence, Gustave accompagne sa soeur et son mari lors de leur lune de miel en Italie. De retour en France, sa soeur meurt brutalement après avoir mis au monde sa fille, nommée également Caroline. La même année, Gustave rencontre Louise Collet, femme mariée avec qui il aura une longue et orageuse liaison.
Flaubert se lie d'amitié avec Maxime Le Camp et entamera une série de voyages qui le mèneront de Bretagne en Orient, puis en Italie. De 1851 à 1856, il écrit Madame Bovary. Le livre paraît en 1856 en feuilleton dans la Revue de Paris de Du Camp, puis en librairie en 1857. La publiction est suivit d'un procès pour atteinte aux bonnes moeurs. Flaubert devient célèbre. Il commence la rédaction de Salammbô. Il part en Algérie et en Tunisie, puis rentre à Paris où il se met à fréquenter les milieux littéraires. Il y rencontre Théophile Gautier. En 1864, il est invité à Compiègne chez l'Empereur Napoléon III. Il reçoit la Légion d'Honneur. Flaubert, qui a rencontré auparavant Yvan Tourgueniev, l'invite dans la maison familiale à Croisset en 1868. En 1869, L'Education Sentimentale est publiée. Le livre est très critiqué, mais George Sand et Emile Zola défendent Flaubert. Puis Flaubert écrit Bouvard et Pécuchet, la Tentation de Saint-Antoine. George Sand meurt en 1876. Flaubert a du mal a trouver de l'argent. Poursuivi par les créanciers, épuisé, il meurt meurt subitement le 8 mai 1880, d'une hémorragie cérébrale.
|
 |
 |
François de Salignac de La Mothe dit Fénelon (1651-1715)
Il naît au château de Fenelon dans le Périgord. Après ses études, il se dirige vers la religion et suit le séminaire de Saint-Sulpice. Ordonné prêtre vers 1675 il se voit proposer la direction de l'établissement des Nouvelles catholiques. Fénelon y reste pendant dix ans. C'est pendant cette période qu'il commence à écrire quelques traités, comme les "Dialogues sur l'Eloquence" (1681) ou son fameux "Traité de l'Education des Filles" (1689). Louis XIV entend parler de lui et l'engage comme précepteur de son petit-fils, le duc de Bourgogne (1689). Et en 1698, il est nommé par le roi archevêque de Cambrai en 1695, mais continue d'enseigner. Pour parfaire l'éducation de l'enfant royal, il lui écrit des "Fables" en prose : les "Dialogues de la mort" et les "Aventures de Télémaque" (1699). Fénelon écrivit une partie de Télémaque lors d'un séjour à Manot. Cet ouvrage, très politisé et très critique, déplaît au roi Soleil. Dans ce livre, Télémaque, fils d'Ulysse, part à la recherche de son père avec l'aide de la déesse Athéna (Minerve chez Fénélon). Fénélon en profite pour distiller de nombreuses notions de géographie, d'économie et de morale. Vers 1693, l'écrivain adhère à la la doctrine quiétiste, condamnée par l'Eglise. Le quiétisme faisait consister la perfection chrétienne dans l'amour de Dieu et la confiance de l'âme. Son ami, Jacques Bossuet, prend alors violemment partie contre Fénelon. Celui-ci est frappé d'ostracisme et se retire dans son archevêché. Il y rédigea pour l'Académie française (dont il était membre depuis 1693) de nombreux textes, dont la Lettre sur les occupations de l'Académie (1714), son véritable testament littéraire. Fénelon meurt à Cambrai le 7 janvier 1715.
|
 |
 |
François Ier (Cognac 1494- Rambouillet 1547)
François Ier succéda à son cousin et beau-père Louis XII, qui mourait sans héritier mâle. L'année précédente, il avait épousé à Saint-Germain-en-Laye la fille de Louis XII, Claude de France. Il régna sur la France pendant 32 ans, imposant sa forte personnalité et se mesurant, à l'extérieur de son territoire, avec les Habsbourg. Il représentait le mieux la Renaissance et développa un goût prononcé pour l'élégance, les belles femmes et les belles choses. C'est à cette époque qu'apparut la formule "Votre Majesté", employée à l'égard de François Ier. Le roi aime l'art et prend sous son aile des poètes comme Joachim du Bellay ou Ronsard, ainsi que des peintres italiens, comme Léonard de Vinci. François Ier intervient également sur le plan architectural et fait construire ou restauré certains château de la Loire, comme Blois et Chambord, ou encore le château de Fontainebleau. Il eut le temps de se remarier, à la mort de Claude en 1530, avec Eleonore d'Autriche. Il meurt dans le château de Rambouillet.
|
 |
 |
Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654)
Il nait à Balzac à 4 km au nord d'Angoulême, le 31 mai 1597, l'écrivain s'appropria le nom du village. Il fait ses études dans sa ville d'origine, puis à Poitiers. Il termine sa formation à l'université de Leyde. C'est à 17 ans qu'il écrit son premier livre : "Discours sur l'Etat Politique des Provinces Unies". En 1921, il part un an à Rome en qualité de secrétaire de l'Archevêque de Toulouse. De retour à Paris, il décide de se consacrer à la littéraire. Sans emploi à la cour, pas même nanti de la moindre abbaye, il se réfugie dans son petit domaine et s 'y veut "l'ermite de la Charente", entretenant une correspondance avec des gens de goût de la capitale qui s'extasient sur le style de ses lettres. Il se met à écrire de nombreuses lettres sur des sujets de morale et de philosophie. ces dernières, éditées en recueils, rencontrent un très bon écho dans toute l'Europe. Admis à l'Académie Française en mars 1634, il ne s'y rend qu'une seule fois pour cause de faible santé. Ses différentes prises de positions lui valent railleries et injures de la part de ses détracteurs. Il est en quelque sorte le réformateur de la prose française. Il connaissait l'italien et l'espagnol et puisait également son inspiration dans les grands écrivains d'antiquité latine. C'était un homme éloquent, un virtuose des mots et de la construction des phrases. Il publia 27 livres de Lettres et environ 70 Dissertations, ainsi que quelques Traités, dont "Le Prince" et "Le Barbon", et trois volumes de vers latins. Vers la fin de sa vie, il versa dans la dévotion et exprima le vœu que son corps reposât dans la chapelle du couvent des cordeliers d'Angoulême (aujourd'hui Chapelle de l'Hôpital) où l'on peut voir son tombeau. Guez de Balzac meurt le 8 février 1654.
|
 |
 |
Richard Hennessy (1724-1800)
Né à Cork (Irlande), il est le fils cadet de Charles Hennessy, seigneur de Baillymacmoy. Après douze ans de service dans la Brigade irlandaise des régiments de Louis XV, il quitte l'armée et part se marier en Angleterre. De retour sur le continent, il s'installe d'abord à Ostende puis à Tonnay-Charente. C'est là qu'il crée la Société Hennessy-Conely et compagnie. En 1765, il fonde une nouvelle société à Cognac qu'il abandonna, un temps, pour Bordeaux (1776-1778). À son retour sur les rives de la Charente, il s'associe avec son fils Jacques ('Richard Hennessy et fils'). En 1794, ils développent outre-mer le commerce des eaux-de-vie en commençant par New York. Après la mort de son père (1800), Jacques épouse Marthe Henriette Martell, annonçant ainsi l'alliance entre les deux maisons.
|
 |
 |
François de La Rochefoucauld (mort en 1541)
Ce fut le premier comte de l'illustre famille de La Rochefoucauld, qui régna sur ce comté charentais pendant plusieurs siècles. Il érigea la baronnie de La Rochefoucauld en comté en avril 1528. François devint ensuite chambellan des rois Charles VIII et Louis XII. Il fut également le parrain du futur roi François Ier (né le 12 septembre 1494 à Cognac).
|
 |
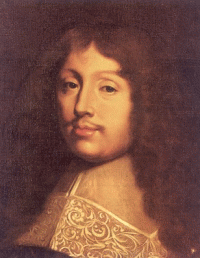 |
François VI de La Rochefoucauld (1613-1680)
Descendant de la célèbre famille des La Rochefoucauld
Membre de l'illustre famille dont le château domine la localité charentaise du même nom, il était destiné à mener une brillante carrière militaire. Mais c'est le monde des lettres qui devait l'immortaliser pour l'histoire. Il arrive à la cour en 1629 où son esprit déjà romanesque et aventureux le pousse, malencontreusement, vers Madame de Chevreuse, âme d'un petit complot contre Richelieu. Une femme qui, une fois l'affaire découverte, fait perdre la tête au malheureux comte de Chalais tandis que le jeune François VI se retrouve embastillé puis exilé dans le château familial de Verteuil (Charente). Plus tard, Mazarin n'est pas plus tendre envers lui lorsqu'il lui refuse tout net deux privilèges sans lesquels la vie au Louvre n'est plus possible : un tabouret pour son épouse, dame d'honneur du palais, et pour lui le droit d'entrer en carrosse dans la cour de ce dernier- François, dès lors, se fait frondeur aux côtés de Condé. Il s'illustre auprès du prince de Condé contre Mazarin lors de la Fronde. Hélas une arquebusade lui emporta la moitié du visage au combat de la porte Saint-Antoine (1652). Amnistié, retiré de nouveau à Verteuil, il se met à fréquenter les salons de Madame de Sablé et de Madame de La Fayette, qui est une de ses amies. Pensionné, il revient néanmoins à la cour. Il prend la plume et publie ses Maximes (1664-1665) dans lesquelles il manifeste son dégoût pour un monde, où selon lui, les meilleurs sentiments ne sont guidés que par l'intérêt personnel. Le ton général est donné par la suivante, entre cinq cent trois autres : 'Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons dans la composition des remèdes'. Il refuse d'entrer à l'Académie française et montre jusqu'à la fin de sa vie une grande lucidité sur le monde et les hommes, ainsi qu'une grande droiture. II meurt dans ses terres en 1680, désabusé sur lui comme sur les hommes, en général.
|
 |
 |
François XD, duc de La Rochefoucauld (1747-1827)
Un descendant de l'auteur des Maximes mais plus positif car philanthrope et presque sympathisant de la Révolution. Celle-ci lui offre l'occasion d'un mot historique célèbre, sa réponse à Louis XVI - 'Non, sire, c'est une révolution.' - qui, devant l'agitation parisienne, vient de lui demander : 'Est-ce une émeute ?'. Exilé en 1792, il passe en Angleterre puis aux États-Unis. À son retour en France, il fonde la première Caisse d'Épargne et l'École nationale des Arts et Métiers.
|
 |
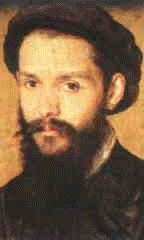 |
Clément Marot (Cahors 1497-Turin 1544)
Fils de Jean Marot, Clément Marot passe son enfance en Quercy, terre de langue d'Oc. Ses études sont loin d'être brillantes. Mais c'est un homme ambitieux. Il se rapproche de la cour royale. Ainsi , lorsque François 1er monte sur le trône, en 1515, Marot lui compose un hommage (Temple de Cupido). François Ier le prend comme valet de chambre et amuseur. Mais soupçonné de sympathie pour la Réforme, il doit s'exiler, notamment avec l'aide de la soeur de François Ier, Marguerite de Navare. En effet, lors de l'affaire des Placards en 1534, lorsque les hoguenots sont pourchassés à travers tout le pays, Clément Marot est soupçonné de sympathie avec les protestants. Il se réfugie à Ferrare. Il n'a jamais arrêté d'écrire. Ce grand poète du XVIe siècle a en effet publié de nombreux ouvrages dont les Epîtres, les Epigrammes, les Elégies, ou encore L'adolescence Clémentine et les Oeuvres Poétiques Complètes. Mais c'était également un admirateur du poète François Villon dont il a réalisé une adaptation des poèmes en 1533. C'était un hédoniste, un fervent défenseur de l'Amour. Il meurt à Turin le 10 septembre 1544.
|
 |
 |
Jean Martell (1694-1753)
Né à Jersey, il s'établit à Cognac (1715) et s'associe avec un négociant de Bordeaux, Jean Hot. La société ayant fait faillite, Jean Martell revient à Cognac (1728) où il épouse en secondes noces Rachel Lallemand (1737). Après sa mort, sa veuve s'associe avec son frère ('Veuve Martell-Lallemand'), puis ses deux fils, Jean et Frédéric, entrent dans la société qui prend le nom de 'Martell et Cie' (1819). Édouard Martell, le dernier descendant de la famille, s'éteint en 1920 et avec lui la dynastie. Sa sœur ayant épousé Paul Firino (+ 1876), leur fils René (1856-1906) joint son nom à celui de Martell.
|
 |
 |
François Mitterrand (1916-1996)
Né à Jarnac le 26 octobre 1916, François Mitterrand poursuit de brillantes études de Droit, de Lettres et de Sciences Politiques à Paris. Mobilisé en 1939, il s'évade en décembre 1941. De retour en France, il entre dans la Résistance. Cet engagement le marque profondément et François décide d'entrer en politique. Sa carrière politique débute en août 1944 lors de sa participation à l'éphémère gouvernement des secrétaires généraux chargé par le Général de Gaulle de gouverner la France jusqu'à l'installation du gouvernement provisoire à Paris. Elu député de la Nièvre en novembre 1946, puis Ministre de la France d'outre-mer, il s'engage de plus en plus dans la vie politique française et internationale. Pierre Mendès-France le nomme Ministre de l'Intérieur en 1954. Mitterrand devient ensuite Garde des Sceaux dans le cabinet de Guy Mollet en 1956.
Maire de Château-Chinon en 1959, il gravit un échelon dans le département de la Nièvre en tant que Président du Conseil Général de la Nièvre. De 1965 à 1968, il est président de la Fédération de la Gauche Démocratique, ce qui lui permet de se présenter en 1965 à l'élection présidentielle. C'est le début de sa conquète du pouvoir présidentiel. Au congrès d'Epinay en 1971, François Mitterrand est élu premier secrétaire du Parti Socialiste. Il conservera ce poste jusqu'à son élection en 1981. Cette dernière le propulse enfin au poste tant convoité de Président de la République.
La France entre alors dans ce que l'on appelle les "années Mitterrand". Ce dernier marque fortement la vie politique et culturelle française. C'est en effet sous sa présidence que naissent les radios libres, qu'est abolie la peine de mort ou que tombe le mur de Berlin, rideau de fer symbolique entre l'Est et l'Ouest. Mitterrand traverse également des périodes de doute lors des cohabitations de 1986-1988 et de 1993-1995. Le Président tient absolument à laisser des traces de son passage. Il fait construire l'Arche de la Défense, la Pyramide du Louvre, ou encore la Bibliothèque Nationale qui porte son nom. Après avoir révélé à la France un de ses grands secrets (sa fille Mazarine Pingeot), François Mitterrand meurt à Paris le 8 janvier 1996.
|
 |
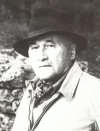 |
Jean Monnet (9 novembre 1888-16 mars 1979)
Il voit le jour a Cognac, dans une famille de négociants en eau de vie. Dans ses Mémoires (Fayard, 1976) le " Père de l'Europe ", auteur du fameux Plan qui porte son nom (1946), évoque son enfance à Cognac, sa ville natale, au sein d'une famille issue du terroir environnant. Son grand-père paternel est propriétaire à Cherves et son père assure la gérance de la "Société des propriétaires vinicoles de Cognac", fondée en 1838. Lorsque ce dernier lance sur le marché sa propre marque ("Cognac J.-G. Monnet") pour laquelle Cappellio dessine une affiche célèbre. Embauché dans l'entreprise familiale, à 16 ans, il parcourt le monde et découvre le Canada, l'Angleterre et les Etats-Unis. Pendant la guerre 1914-1918, il travaille à Londres, où il organise le Bureau de Ravitaillement allié. Puis Jean Monnet participe en 1919 à la création de la Société des Nations dont il est le secrétaire général adjoint. Financier International, il redresse la gestion de l'entreprise familiale à Cognac avant de participer au redressement économique de certains pays d'Europe Centrale et Orientale. On le retrouve en Chine, puis en Angleterre, puis aux Etats-Unis en 1940, où il négocie l'achat de fournitures de guerre. En 1943, Jean Monnet devient à Alger un membre du gouvernement de la France Libre. A la Libération, c'est Charles de Gaulle qui lui demande de relancer l'économie française. Mais c'est surtout en 1950 que Jean Monnet va changer la vie politique européenne en concevant, dans sa maison d'Houjarray, l'idée de la Communauté Européenne qui voit le jour en 1952 sous le titre de CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier). Et en 1955, il crée le "Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe" qui sera à l'origine de nombreux projets européen comme le Traité de Rome ou le système monétaire européen. Lors de sa retraite, qu'il passe dans se maison des Yvelines, il rédige ses mémoires dans lesquelles il lègue sa conviction d'une Europe unie.
- La fin de la Seconde Guerre mondiale orienta différemment son destin.
|
 |
 |
Marc-René de Montalembert (1714-1800)
Homme à cordes multiples, Montalembert fut l'un des plus grands ingénieurs français. Général au service de la Suède, membre de l'ancienne Académie des Sciences en 1747 à l'age de trente-trois ans, il écrivit quelques chansons et contes en vers. Il s'illustra dans de nombreuses batailles, mais aussi à travers ses idées sur la défense. Il est connu en Charente pour la construction de la fonderie de Ruelle. Cette dernière fut aménagée dans un ancien moulin à Ruelle en 1750. Cette fonderie, construite sur les bords de la Touvre, était destinée à fournir des pièces de canon de gros calibre.
|
 |
 |
Jean-Bastier de la Péruse (1529-1554?)
Jean Bastier de La Péruse est né en 1529, à La Péruse, ou plus exactement à Pont-Sigoulant, sur la Charente. Il se rend à 20 ans à Paris, afin d'y poursuivre des études universitaires. C'est là qu'il rencontre Ronsard, Baïf, du Bellay, Jodelle..., qui le feront entrer vers la fin de sa vie dans leur groupe, la Pléiade. Jean-Bastier écrit Médée, une tragédie. Cette pièce, même si elle n'est pas jouée, rencontre un grand succès. En 1532, le poète quitte Paris et part à Poitiers terminer ses études juridiques. Il y rencontre celle qui sera sa muse, Catherine Cottel. Mais chassé par la peste, il rentre en Charente. Très malade, il meurt à la fin de l'année 1554. De nombreux poèmes, odes et autres sonnets sont publiées à titre posthume.
|
 |
 |
Poltrot de Méré (vers 1537-1563)
Poltrot, né en Angoumois, passe sa jeunesse en Espagne. On le surnomme alors l'espagnolet. A son retour en France, il embrasse la religion protestante et jure alors de tuer François Ier de Lorraine, deuxième duc de Guise et catholique fervent. Poltrot de Méré tue le duc de Guise alors que ce dernier vient d'enchaîner les victoires contre les huguenots à Rouen, en octobre 1562, et à Dreux, en décembre de la même année. François de Guise tente de reprendre Orléans lorsque Poltrot de Méré le surprend et lui tire de très près un coup de pistolet dans l'épaule. Le duc gravement blessé meurt 6 jours après l'attentat. Poltrot est alors condamné à mort par écartèmement. Les suplices des bourreaux étaient alors particulièrement cruels et raffinés : Il fut ainsi déchiré avec des tenailles ardentes, tiré à quatre chevaux et écartelé.
|
 |
 |
Jean-Baptiste de La Quintinie (1er mars 1626-11 novembre 1688)
Né à Chabanais, Jean-Baptiste La Quintinie fait ses études au collège des Jésuites à Poitiers, puis à la faculté de philosophie et de droit. Ensuite, arrivé à Paris, il entamme une carrière d'avocat à la cour du Parlement. Il y rencontre Jean Tambonneau, président de la Cour des Comptes. ce dernier l'engage comme précepteur et lui confie l'éducation de son fils. Jean-Baptiste emmène le fils Tambonneau dans une grande virée en Italie. Ce voyage agit sur Quinitine comme un révélateur. Finit le droit, il va désormais consacrer sa vie à l'horticulture. Lorsque les travaux du château de Vaux-Le-Vicomte débutent, Jean-Baptiste s'y rend et apprend le métier de jardinier auprès de Le Vau, Le Brun et Le Nôtre. Ses premiers jardins se retrouvent à Sceaux et à Rambouillet. En 1670, c'est la consécration : Quintinie, choisit par Louis XIV en personne, hérite du poste de directeur des jardins fruitiers et potagers royaux. De 1678 à 1683, il travaille ainsi sur le nouveau potager du roi à Versailles. Un an avant sa mort, Louis XIV l'anoblit. Après sa mort, son livre "Instruction pour les jardins fruitiers et potagers" est publié.
|
 |
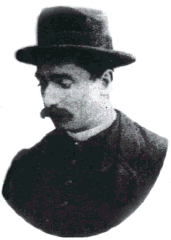 |
Alfred Renoleau (1854-1930)
Alfred Renoleau est né à Mansle en 1854. Il est l'ainé de 5 enfants.
En 1867 il quitte l'école communale et apprend le métier de coiffeur avec son père qui exerce 17 rue Grande à Mansle.
Après avoir effectué son volontariat à Paris en tant que pompier, il revient exercer son métier et épouse Marie-claire Bourdongle le 30 juillet 1878.
Il se passionne pour la céramique à la manière de Bernard Palissy et fabrique dans son grenier des terres vernissées signées "FALDER" dont il fait cadeau à ses amis.
En 1888, il vend son commerce et entre aux Grandes Tuileries de Roumazière à l'usine Polakowski où Sylvestre Bourigeaud lui enseigne l'art de la terre. Il introduit de nouvelles productions aux tuileries.
1888 : il vend son commerce
1890 Il quitte Mansle pour Angoulême
En 1891 il s'associe avec le peintre Goras, apporte son savoir en ce qui concerne la terre et fonde La Faïencerie d'Angoulême au 27 port de l'Houmeau. Il fabrique de la faïence usuelle et de la faïence d'art.En 1895, suite à de nombreux désaccords avec François Goras,il se retire de l'entreprise et s'installe route de Bordeaux dans un immmeuble appartenant au Carmel. Il y construit deux fours.
En 1897, il s'installe définitevement sur les rives de l'Anguienne, 163 rue Basse-de-l'Hémicycle(devenue rue Alfred Renoleau).
dans cette ancienne demeure des évêques d'Angoulême qu'il restaure, il construit lui-même ses fours pour la faïence et un four spécial pour la cuisson du grès.
Les magasins d'exposition et l'atelier de peinture se trouvent au rez-de-chaussée de l'immeuble ; le premier étage est réservé au domicile des Renoleau.
Alfred Renoleau est un artiste, il crèe, il modèle et fabrique lui-même ses moules ; son épouse Claire tient ses comptes et reçoit les clients. La manufacture prospère ; elle comprend jusqu'à une quarantaine d'ouvriers.
De 1895 à 1914, la production est très importante : terres vernissées ou émaillées, grès, faïence, bustes ou médaillons en terre cuite... La guerre de 1914-1918 ralentit et modifie la production.
Alfred Renoleau reste sans postérité, aussi, à l'âge de soixante ans, il laisse son neveu Joseph Roullet, qu'il a formé et a adopté (9 mai 1928), prendre une part progressivement plus importante dans la marche de la fabrique angoumoisine. Il en assume la direction au décès d'Alfred Renoleau (3 août 1930).
Joseph Roullet est le fils de Marie Renoleau, soeur d'Alfred, et de Jules Roullet, libraire à Mansle. Il a épousé Marie Bourdongle(1887-1920) à Mansle, puis Jeanne Pignon en 1922.
|
 |
 |
Claude Roy (1915-1997)
Claude passe son adolescence à Jarnac. Cet écrivain, plein d'humour et de poésie, écrivit de nombreux récits fins, malicieux, fantaisistes, comme Le chat qui parlait malgré lui, Léone et les siens, La maison qui s'envole, A la lisière du temps, Alice et les autres, L'ami lointain, ou encore Les animaux très sagaces. L'écrivain avait de multiples cordes à son arc. Il toucha à toutes les facettes de l'écriture : poèmes, critiques, mémoires, romans, chroniques de journaliste, récits de voyages, livres pour enfants, portraits d'artistes. C'était également un amoureux de l'art. Il rédigea des ouvrages sur Daumier, Modigliani, André Breton, et Balthus. Ce dernier ouvrage est le fruit de l'amitié entre le peintre et l'écrivain. Mais l'homme s'intéressait aussi au cinéma, avec la rédaction de biographies de Gérard Philippe, de Jean Vilar, des articles sur Claude Lanzmann. Puis il se tourne vers des modèles littéraire : Stendhal, Victor Hugo, Camus, Proust... Il décéda à l'âge de 82 ans.
|
 |
 |
Ravaillac (François)
(1578 - 1610) : Né à Touvre. Il gagna paris à pied et assassina Henri IV, rue de la ferronnerie, le 14 Mai 1610. Il fut supplicié le 27 Mai.
|
 |
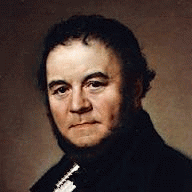 |
Stendhal (Henri Beyle) (Grenoble, 1783 - Paris, 1842)
Stendhal, de son vrai nom Henri Beyle, est né à Grenoble le 23 Janvier 1783 dans une famille honorable de la cité. Son père, Chérubin Beyle, est avocat au Parlement. La mère d'Henri meurt alors qu'il n'a que sept ans. Sa disparition bouleverse l'enfant, très sensible. Henri se révolte alors contre son entourage et trouve refuge chez son grand père maternel, le Docteur Gagnon. Il aide son petit-fils à entrer à l'Ecole Centrale de Grenoble. Et, en 1799, Henry Beyle est prêt à monter à Paris, pour se présenter à l'Ecole Polytechnique. Mais c'est une autre destinée qui l'attend.
Avec l'aide de son cousin, le Comte Pierre Daru, il entame en 1800 une carrière militaire et rejoint l'Armée d'Italie. Henri tombe amoureux de ce pays passionné. Lassé de l'armée, il démissionne en 1802, pensant entamer une carrière d'auteur dramatique. Son heure n'étant pas arrivée, il réintègre l'armée en 1806 et travaille en Allemagne et en Autriche. Menant une vie de dandy, il trouve le temps d'écrire de temps en temps. Il suit Napoléon lors de la Campagne de Russie. L'Italie, qui l'a longtemps hanté, le rappelle sur son territoire. Stendhal s'installe alors à Milan où il demeurera sept ans et compose en 1814 son premier livre sous le titre "Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase", sous le pseudonyme de Louis César Alexandre Bombet. Il publie en 1817 deux livres l'Histoire de la peinture en Italie et sous le pseudonyme de Stendhal. Il est obligé de revenir à Paris en juin 1822.
Stendhal va alors vivre de sa plume. Il fréquente les salons célèbres et publie De l'Amour en 1822, La vie de Rossini en 1823, Racine et Shakespeare en 1823-1825. A 43 ans, Stendhal publie son premier roman, Armance (1827). 1830 est l'année de publication de son premier chef-d'œuvre, Le Rouge et le Noir. Stendhal-Beyle se voit confier l'année suivante le poste de consul à Civitavecchia. Il entreprend durant cette période de grandes œuvres inachevées, comme Une position sociale (1832), Lucien Leuwen (1834-35), Vie de Henry Brulard (1835-36). De retour en France pour une courtepériode, il en 1838 La Chartreuse de Parme qui paraît le 6 Avril 1839. En 1839, il doit retourner en Italie. Mais sa santé se dégrade et Stendhal revient à paris pour se soigner. Le 22 Mars 1842, Stendhal meurt dans la nuit. Il est inhumé au cimetière Montmartre.
|
 |
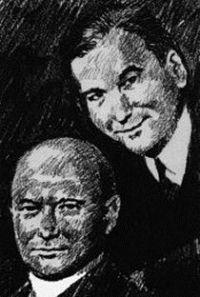 |
Jérôme (1874-1953) et Jean (1877-1952) Tharaud
Né dans la Haute-Vienne, Jérôme Tharaud fit ses études à Angoulême, puis à Paris. En 1896, il entre à l'École Normale Supérieure dans la section lettres. Prof à Budapest, il rentra rapidement en France, où il devint, en 1901, secrétaire de Maurice Barrès. Il occupa ce poste jusqu'à la Première Guerre mondiale. Quant à Jean, il tente le concours de Saint-Cyr, mais échoue et se lance dans les lettres. En 1898, les deux frères publièrent un premier livre, Le Coltineur débile. Ils collaborèrent ensuite régulièrement. Dingley, l'illustre écrivain, critique de Kipling et de l'impérialisme anglais, leur fit obtenir en 1906 le prix Goncourt. Pendant cinquante ans, Jérôme et Jean Tharaud parcoururent le monde, notamment l'Orient et l'Europe de l'Est, en ramenant reportages et sujets de livres, parmi lesquels on retiendra surtout la série marocaine : Marrakech ou les seigneurs de l'Atlas, Rabat ou les Heures marocaines, Fès ou le Bourgeois de l'Islam, La nuit de Fès.Leur oeuvre est particulièrement riche et fournie. Jérôme est élu en 1938 au fauteuil 31 de l'Académie Française. Quant à Jean, il est élu en 1946 au fauteuil 4. Avec Maurice et Louis de Broglie (élus respectivement en 1934 et 1944), Jérôme et Jean Tharaud constituaient le second duo fraternel à siéger sous la Coupole, au XXe siècle.
|
 |
 |
Ludovic Trarieux (1840-1904)
Né à Aubeterre-sur-Dronne, Ludovic Trarieux fait de brillantes études de droit. Mais c'est lors de l'affaire Dreyfus que s'illustre Trarieux. En 1877, Ludovic Trarieux, fervent républicain, est élu bâtonnier au Barreau de Bordeaux. En 1895, Trarieux devient Ministre de la Justice. L'année précédente éclatait l'affaire Dreyfus. Le samedi 13 octobre 1894, le capitaine Dreyfus reçoit une convocation à son domicile de l'avenue du Trocadéro. Ce dernier est accusé d'espionnage pour le compte des Allemands. Très vite, la France se divise en deux. D'un côté, il y a les Dreyfusards, de l'autre les anti-Dreyfusards. Le 6 janvier 1898, Ludovic Trarieux adresse une lettre ouverte au Le Temps. Les arguments sont repris avec éclat par Zola pour son " J'accuse " du 13 janvier de la même année. Le procès de Zola a lieu dès le mois de février. Trarieux décide de témoigner en faveur de l'écrivain en créant l'Association de la Ligue des Droits de l'Homme pour la "sauvegarde des libertés individuelles". Le 4 juin a lieu la première assemblée générale de la Ligue. Renseignements : Ligue des droits de l'homme (LDH). 27, rue Jean-Dolent, 75014 Paris. Elle défend aujourd'hui les victimes de l'arbitraire, de l'injustice ou de la discrimination et promeut l'application des
|
 |
 |
Maurice Utrillo (1883-1955)
Maurice Valadon voit le jour le 26 décembre 1883, au 8 rue du Poteau dans le 18e arrondissement à Paris. C'est le fils de Marie Clémentine Valadon (1865 - 1938) dite "Suzanne". Né d'un père inconnu, il est reconnu officiellement en 1891 par Miguel Utrillo. Mais sa mère, modèle de Puvis de Chavannes, Renoir et Toulouse-Lautrec le délaisse. Le petit Maurice est confié à sa grand-mère. Mais pour supporter l'abandon de sa mère, il trouve bientôt refuge dans l'alcool. En 1900, Maurice arrête ses études et vit de petits boulots. Dès l'âge de 21 ans, les premiers symptômes de dérangements apparaissent. Commencent alors les colères explosives, les scandales, les internements successifs, qui le poursuivront pendant de longues années. Il est interné en 1904 à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Mais cette période de souffrance déclanche en lui le désir de peindre. Sa mère l'encourage dans cette voie. En 1905, la famille déménage à Montmagny. Utrillo peint régulièrement les paysages de Montmagny et les quais de la Seine. Mais sa mère divorce en 1910. Utrillo traverse alors une période blanche. Il est toujours régulièrement interné. Dès 1925, sa renommée dépasse les frontières françaises. Les expositions se multiplient. En 1935, il épouse Lucie Pauwels. le couple s'installe à Angoulême. Suzanne Valadon meurt en 1938. Maurice vit très mal la disparition de sa mère. Il déménage et va habiter avec sa femme au Vésinet où il mènera jusqu'à la fin de sa vie une existence paisible. Peu de temps avant sa mort, Utrillo participe au film de Sacha Guitry "Si Paris m'était conté". Utrillo peindra jusqu'à sa mort, le 5 novembre 1955.
|
 |
 |
Alfred de Vigny (1797-1863)
Alfred de Vigny naquit à Loches, le 27 mars. Mais sa famille déménagea rapidement à Paris. De 1816 à 1827, Vigny poursuivit une carrière d'officier d'infanterie. Mais c'était surtout un grand poète et un brillant écrivain, amoureux de la vie. Les femmes comptèrent énormément pour lui, sa mère aussi bien que sa femme, l'anglaise Lydia Bunbury, ou ses maîtresses, Delphine Gray ou Marie Dorval. Elles inspirèrent Vigny et l'on retrouve leurs présences dans certains de ses écrits. C'est au manoir du Maine-Giraud (XVe siècle), propriété de la famille Vigny dès le XVIIIe siècle qu'Alfred de Vigny composa ses plus beaux poèmes (la Mort du Loup, la Maison du Berger, La Mort du Loup, Les Destinées, L'Esprit Pur, Journal d'un poète). C'était également un grand romancier. Cinq mars publié en 1826 rencontre un vif succés. Vigny y reprit un épisode de l'histoire de France : Le complot de Cinq-Mars contre Louis XIII. Stello, le deuxième roman de Vigny, parait en 1832. Servitude et Grandeurs paraissent en 1835. Grand admirateur de Shakespeare - Vigny avait découvert ce dernier en 1827 lors de son mariage avec son anglaise - il traduisit plusieurs des pièces du dramaturge anglais, dont Othello, Le Maure de Venise. Il s'essaya également à l'écriture théâtrale et rencontre le succés en 1835 avec Chatterton, inspirée d'un poète anglais. Mais les mots seuls ne provoquaient pas toujours l'ivresse. Alfred de Vigny aimait la vigne et s'occupait avec attention du vignoble du Maine-Giraud. La Distillerie et les chais du domaine se visitent toujours. En 1862, sa femme meurt. Vigny ne lui survécu pas très longtemps et rend son dernier souffle un an plus tard.
|
 |
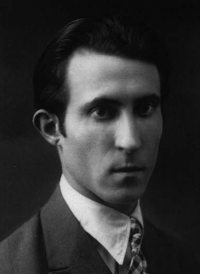 |
Pierre Véry (1900-1960)
Pierre Véry naît à Bellon, le 17 novembre 1900, dans une famille d'agriculteurs. Ayant obtenu son certificat d'études, il est envoyé en pensio au Petit Séminaire de Meaux. A sa sortie de pension, il exerce différents petits métiers avant de s'embarquer sur un cargo en direction du Maroc. De retour à Paris, il ouvre une librairie dans la rue Monsieur-le-Prince. C'est à cette époque qu'il commence à fréquenter les milieux littéraires. Il épouse Jeanne Rouvin dont il eut trois enfants. Son premier roman, Pont Egaré, publié en 1930, rencontre un certain succès. Il est même évoqué lors de la remise du Prix Goncourt. Son roman, le Gentelman des Antipodes, remporte le premier Grand Prix du Roman Policier. C'est à partir de ce roman que Pierre Véry se lance dans le récit policier. Il écrit alors Les Disparus de Saint-Agil, adaptés à la télévision, ou encore Goupil Mains Rouges, L'assassin a peur la nuit, L'assassinat du Père Noël, Cinéma Cyanure et Compagnie, L'inconnue du terrain vague, ou encore M. Marcel des pompes funèbres. En 1952, il lance une émission policière radiophonique : Fait-Divers. Il meurt en octobre 1960.
|
 |
 |
Jean de Valois (1400–1467)
Cognac et son château gardent la mémoire de ce comte d’Angoulême, fils du duc d’Orléans. Né à Orléans, il hérite du comté à la mort de son père, assassiné par les hommes du Duc de Bourgogne (1407), prélude à la Guerre de 100 ans entre les Armagnacs et les Bourguignons. Membre de ce dernier parti, son frère Charles d’Orléans appelle les anglais et négocie avec eux le traité qui fait de Jean leur otage (1412). Au lendemain du désastre français d’Azincourt (1415), les deux frères se retrouvent captifs en Angleterre jusqu’en 1440. A son retour en France, Jean de Valois s’établit à cognac. Il fait relever le château familial, ruiné par la guerre , et s’occupe activement de restaurer ses domaines, son vignoble en particulier. Ses bienfaits lui attirent de la part de la population l’affectueuse appellation de ‘bon Comte Jean’. Il fut le grand père de ce célèbre personnage : François Ier et Marguerite de Valois.
|
 |
 |
Marguerite de Valois ou d'Angoulême (1492-1549)
Fille de Charles d'Orléans et Louise de Savoie, Marguerite naît en 1492 au château d'Angoulême. Elle épouse en première noce Charles II, Duc d'Alençon. Rapidement veuve, elle se remarie en 1527 à Henri d'Albret, roi de Navarre. C'est une femme cultivée et intelligente. Toute sa vie, elle restera une des plus fidèles conseillères de son frère, le Roi de France François Ier. Tout au long de ce double itinéraire, celle que la Renaissance surnomma 'Marguerite des Princesses' proméne sa grande taille, son charme à défaut de beauté, sa bonté, sa douceur et, surtout, son savoir qui l'inscrit parmi les tout premiers humanistes de son temps. Elle connait le grec, le latin, l'italien, l'espagnol et, dit-on, l'hébreu. Elle compose des poésies mystiques ou profanes et voue la dernière partie de sa vie à la rédaction de l'Heptaméron, un recueil de contes modelés à l'exemple du Décaméron de Boccace. Ce livre est conçu par la jeune femme lors d'une cure thermale à Cauteret. Celle-ci a réuni dix amis et leur demande de raconter chacun une histoire par jour pendant dix jours. Ils n'iront pas jusqu'au bout du pari, mais l'ouvrage sort et connaît un vif succès. L'Heptaméron rassemble des 72 nouvelles, anecdotes réelles ou fictions.
En 1547, Marguerite de Navarre approche de la fin de sa vie. Pour réfléchir, et se consacrer à la méditation, elle se retire dans l'abbaye de Tusson. En mars, elle se rend à Tusson pour y faire une retraite. Mais à la même période, son frère François Ier tombe malade et meurt rapidement. De peur d'affoler Marguerite, on ne lui apprend la nouvelle que quinze jours après. La reine décide alors de rester à Tusson où elle fait construire un logis. Mais elle n'y reste pas et part à Mont-de-Marsan, puis à Nérac, où elle meurt le 21 décembre 1549.
|
 |
Sources :
Chemins 16
Charente-Limousin
Xaintonge
Saintonge en ligne
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Villefagnan
Petit Futé
Ainsi que Monsieur Coutanceau qui a fournit plusieurs photos et des précisions sur les dates :)
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|


