 |
| L'Angoumois dans tous ses états ... |
|
|
|
| |
|
| |
|
 |
Produits Régionaux
et
Traditions |
 |
|
|
 |
 |
Les Charentaises :
L'histoire de la Charentaise, ce confortable et inégalable chausson au dessus de type écossais, est liée à celle de Colbert, contrôleur général des finances de Louis XIV. En 1666, Colbert ordonne la fortification de la ville de Rochefort. C'est Vauban qui s'y colle alors. En même temps, Colbert fait construire un port militaire près de l'embouchure de la Charente. Cette arrivée massive de main-d'oeuvre et de militaire dope alors l'économie locale en amont de la Charente. La marine sollicite alors énormément les artisans de la région. Le feutre foulonné dans les nombreux moulins charentais fait partie de ces commandes. Comme les militaires ne veulent que le meilleur du feutre, les rebuts sont recyclés et utilisés comme pantoufles à glisser dans les sabots. Ces dernières sont également utilisées pour faire briller les parquets, notamment ceux du château de La Rochefoucauld. C'est un cordonnier de La Rochefoucauld qui aurait eu l'idée de poser une semelle rigide sous la pantoufle. Mais la véritable "charentaise" n'apparaît qu'au XXe siècle, grâce aux inventions d'André Chaignaud, industriel rupificaldien (i.e. de La Rochefoucauld). Il invente le collage du feutre et crée des pantoufle aux couleurs vives et aux décors de type écossais. Un autre industriel de la ville, James Rondinaud, les exporte. C'est le succès. La charentaise révolutionne ainsi à jamais le confort et le bien-être des pieds ! Vous pouvez les trouver dans tous les bons magasins, mais aussi au magasin d'usine Rondinaud, sur la Route Nationale 141 à Chasseneuil, ou encore à La Rochefoucauld.
Sources :
Petit Futé
|
 |
 |
|
Le matin j'embauche et le soir je débauche. N'aillez pas peur, il n'y a pas d'atteinte aux bonnes moeurs et la Charente n'est pas le pays de la luxure.
On veut juste dit que le matin on va travailler et le soir on part du travail. J'ai déjà eu des remarques à ce sujet, de la part de bretons notamment, qui ne comprenaient pas ce que je voulais dire par là ;).
|
 |
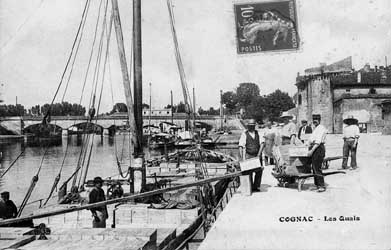 |
Les Gabares :
Vers 1800, le village de Saint-Simon comptait 700 habitants, presque tous marins. C'était une halte privilégiée des gabariers, un lieu de construction et de réparation des gabares. Dès le Moyen Age et surtout vers le XVI et XVII siècles de nombreux charpentiers, calfats, construisaient des bateaux perpétuant un savoir vieux de plusieurs siècles. Au XIX siècle la cité devient le centre le plus important de construction de gabares de tout le fleuve. Les gabares servaient au transport de marchandise. Mais elles étaient également utilisées pour transporter les barriques d'eau de vie ou de vin de chais à chais, puis pour les acheminer par la Charente jusqu'à l'océan où elles étaient chargées sur des navires. Ce moyen de transport fluvial fut utilisé jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. De son passé de village gabarier, Saint-Simon a conservé des souvenirs, des archives, des outils racontant l'histoire des marins. Vous pourrez également monter, quai de Juac, sur une véritable gabare, La Renaissance, pour une ballade d'une heure sur la Charente. Vous verrez ainsi le chemin de halage, le village gabarier de Saint Simon, les restes des anciens chantiers de construction des gabarres, l'ile aux vaches, et les portes de l'écluse de Vibrac.
Les mâts des gabares sont repliables, comme nous le constatons sur l'embarcation du premier plan sur cette carte. La navigation sur la Charente n'est en réalité pas aisée. Il faut plusieurs jours pour atteindre la côte en partant du port L'Houmeau à Angoulême . Et parfois,
une gabare s'échoue, comme celle
qui reste quelques années prés du
bateau-lavoir avant d'être renflouée .
Sources :
Petit Futé
Comité Régional du Tourisme Poitou-Charentes
|
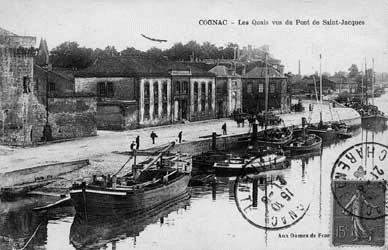 |
 |
 |
Les moulins :
Moulins à eau de la Charente ou moulins à vent du Ruffecois, ces moulins fabriquaient inlassablement papier, huile de noix, ou farine. Le XIXe siècle constitue l'âge d'or des moulins à vent. En 1818, on en rescensait 124 en Charente. Mais les minoteries ont pris progressivement la place de ces vieux moulins. Il en reste pourtant encore dans la région. Certains ont été restaurés et continuent à fabriquer de la farine et de l'huile de noix. De la puissante industrie du papier, autrefois fabriqué dans les moulins, il reste encore une dizaine de papeteries, qui ont su adapter leur production et se spécialiser pour survivre.
Sources :
Petit Futé
|
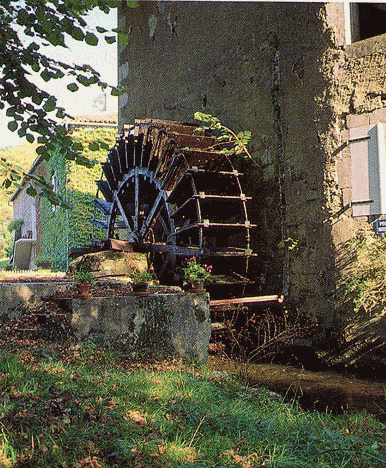 |
 |
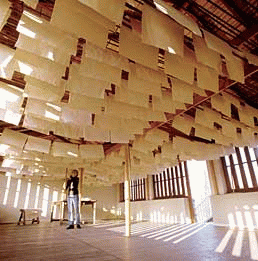 |
Industrie du papier et du carton :
L'industrie du papier et du carton en Poitou-Charentes est le fruit d'une tradition qui remonte au Moyen Âge.
C'est à partir de 1516 que les premiers moulins sont implantés en Charente pour fouler chiffons de lin, de chanvre, de coton et en faire de la pâte à papier.
A la Renaissance, François Ier, natif de Cognac, fit réaliser des travaux facilitant la navigation sur les cours d'eau et accorda de nombreux privilèges aux papetiers. Il favorisa ainsi l'expansion de leurs activités.
A la fin du XVIIème siècle, le département de la Charente comptait plus de 150 moulins à papier.
Au XVIIIe siècle, le papier royal d'Angoumois devint le plus recherché de son temps. On reconnaissait la supériorité des papiers d'Angoulême soit pour l'écriture soit pour l'impression. On leur accordait la préférence même sur les papiers d'Auvergne. Il y avait alors pas moins de 70 papeteries qui exportaient leur production vers toute l'Europe. Ce papier était connu sous le nom de "Velin". Le vélin était, au Moyen-Age, le nom donné à une peau de veau mort-né, parchemin d'une très grande finesse. Les premiers papiers fabriqués sur toile tissée vers 1750 par John Baskerville avaient probablement la même transparence, le même aspect qu'un vélin (peau), d'où le nom donné à la toile. La confusion sera entretenue par l'appellation donnée à une toile métallique d'égouttage, tissée, sans marques ni coutures utilisée sur toutes les machines à table plate pour la fabrication du papier industriel : toile vélin. Le "Vélin d'Angoulême", marque commerciale de papiers pour cahiers d'écoliers et papiers à lettres des Ets Laroche-Joubert jusqu'à la fin des années 1970, a popularisé ce mot en y associant le nom d'une ville papetière.
Au XIXe siècle, l'utilisation du bois pour la fabrication de la pâte à papier entraîna l'industrialisation des papeteries et le déclin des moulins. Toutefois, la qualité et la renommée du vergé des Charentes et du vélin d'Angoumois perdurent jusqu'à nos jours.
A proximité des papetiers, s'implantèrent des entreprises pour transformer le papier. En 1888, la firme Thomson & Norris, exploitant un brevet déposé par Albert L. Jones en 1871, construisit à Exideuil-sur-Vienne (Charente), la première usine de fabrication de carton ondulé. Au vingtième siècle, l'industrie de l'emballage (des bouteilles et des fromages) s'est développée en liaison avec l'industrie agroalimentaire régionale. Parallèlement, quelques établissements se spécialisent dans la fabrication d'articles de papeterie, en particulier les enveloppes. A partir des années 1950, des sociétés conçoivent et réalisent des éléments de packaging dans le domaine de la santé. Alors qu'elle a toujours importé sa pâte à papier, le recyclage des papiers a permis en 2003 à la région Poitou-Charentes de produire de l'ordre de 200 000 tonnes de papier pour ondulé (PPO).
Sources :
La charente, mille et un bonheurs à partager
Maison de l'Imprimerie et du papier
Le Routard
Les LAROCHE - Papetiers de Charente
L'industrie En Poitou-Charentes
|
 |
La faïencerie Roullet-Renoleau :
Techniques de fabrication
Le coulage :
On utilise des moules en plâtre qui représentent la forme désirée
On remplit le moule d'argile liquide appelée barbotine
On laisse le moule rempli de barbotine pendant une heure, avant de le vider
Durant cette période la barbotine épouse la forme des parois du moule. 48 heures plus tard la pièce sera prête à être démoulée
Le démoulage :
On ouvre le moule pour extraire la pièce qui est encore très fragile et devra sécher quelques heures à l'air libre, avant de subir l'étape suivante
Cette technique permet de fabriquer des pièces creuses
Fabrication d'objets plats:
Une autre technique est utilisée Un outil correspondant au demi-profil de l’objet permet l’obtention de celui-ci en faisant tourner une galette d’argile
L’assiette ainsi obtenue pourra être mise à sécher
La finition :
La finition (l’ébarbage) se fait à la main avec des outils simples tels que des lames fines et des éponges.
Cette étape très délicate consiste à lisser et à éliminer toutes les bavures ou « coutures ».
Parfois il faut rajouter une anse ou un pied. 15 jours de séchage sont nécessaires avant de passer à la première cuisson
La cuisson :
La cuisson se fait dans des fours à 1080°. Lorsque les pièces sortent du four après la première cuisson, on les appelle des biscuits. Elles ont pris une belle couleur rouge due à l'oxyde
de fer contenu dans l'argile.
L'émaillage :
Après la première cuisson, on trempe la pièce dans un bain d’émail. Cet émail servira de base à la décoration, c’est lui aussi qui donnera après la deuxième cuisson le brillant à la pièce.
La décoration :
On utilise un « poncif » pour reporter la trame du motif.
Le travail se fait ensuite à main levée avec un pinceau très fin
Les couleurs utilisées sont toujours des oxydes de métaux.
Sources :
Collège Alfred Renoleau
Sur les traces de Bernard Palissy
|
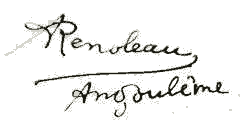 |
 |
Le Safran :
Le safran élément du patrimoine charentais ? Et oui, l'épice orientale aujourd'hui produite en Inde, Iran, Espagne et Maroc, était une des principales ressources de la Charente, ce du Moyen Age jusqu'au XVIIIe siècle. Cette culture fût propagée en Angoumois par Jacques Benoît de l’Age Baston, premier Président de la ville de Bordeaux. Victime de l'hiver 1766 et de l'exode de la main d'oeuvre au XIXe siècle, la plante a disparu avant de réapparaître... en 1997. Cette année là, 50 000 bulbes sont importés d'Iran et des coopératives se sont créées dans le Gâtinais et le Quercy.
Sources :
Histoire passion
Merci à Madame Lacroix pour l'info que le safran :)
|
 |
Les tuiles :
A Roumazière, la tuile est sur presque tous les toits et se retrouve dans le nom même de la ville. Roumazière signifie en effet "rouges ruines". Les habitants y travaillent l'argile depuis des siècles, et leur savoir-faire intéresse aujourd'hui le monde entier. L'argile se plie facilement aux désirs des hommes et se travaille sans problème à la main. En effet, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la fabrication des tuiles reste artisanale.
Les tuiles sont moulées à la main, puis enfournées pour une cuisson de soixante heures. L'arrivée du chemin de fer industrialise ensuite peu à peu la région. En 1875, un ingénieur polonais met en place un procédé de mécanisation de la fabrication des tuiles. Mais le véritable essor industriel débute en 1907, avec la création de la Tuilerie Briqueterie Française, la TBF. Aujourd'hui encore, elle emploie la majorité des habitants de Roumezières.
Sources :
Petit Futé
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
|


